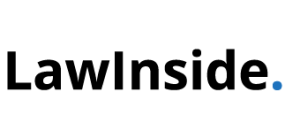La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l’injonction tendant à la résiliation du contrat
L’art. 58 al. 2 AIMP n’est applicable que lorsqu’un contrat de marché public a été conclu durant une procédure de recours dépourvue d’effet suspensif. Lorsque tel n’est pas le cas, les tribunaux administratifs peuvent constater la nullité du contrat de marché public. Subsidiairement, si les conditions de la nullité ne sont pas réalisées, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une injonction contraignant le pouvoir adjudicateur à résilier ou modifier le contrat de marché public.
Faits
Une commune publie un appel d’offres portant sur la construction d’une façade d’un jardin d’enfants. Sur simap.ch, il est indiqué que les soumissionnaires disposent d’un délai au 28 juin 2023, 16h00, pour soumettre leurs offres. La documentation relative à l’appel d’offre prévoit en revanche que les offres peuvent être soumises jusqu’au 28 juin 2023, sans indication d’un horaire précis.
Une entreprise soumet son offre le 28 juin 2023, à 21h47. Cette offre est ensuite classée première. Toutefois, par décisions du 4 août 2023, le pouvoir adjudicateur indique à l’entreprise que son offre a été exclue de la procédure de marché public car déposée tardivement et indique avoir adjugé le marché public à une autre entreprise. Par écriture du 4 septembre, reçue le 8 septembre, l’entreprise recourt contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Thurgovie. Sur mesures provisionnelles, la recourante conclut à ce que le tribunal interdise au pouvoir adjudicateur de conclure un contrat portant sur le marché public litigieux. Au préalable, elle sollicite que l’effet suspensif soit accordé au recours. Au fond, elle conclut à l’annulation de la décision d’exclusion et à la réforme de la décision d’adjudication en ce sens que le marché public lui soit adjugé.
Dès l’écoulement du délai de recours, à savoir le 5 septembre, et malgré le fait qu’il avait connaissance du dépôt du recours, le pouvoir adjudicateur conclut un contrat avec un autre soumissionnaire. Le 8 septembre, le Président du Tribunal accorde l’effet suspensif au recours et interdit au pouvoir adjudicateur de conclure un contrat portant sur le marché public litigieux pour la durée de la procédure. Le 13 mars 2024, le Tribunal administratif admet le recours. Il constate que la recourante a été exclue à tort de la procédure d’adjudication et que le pouvoir adjudicateur a violé l’art. 42 al. 1 AIMP en concluant le contrat. Selon l’art. 58 al. 2 AIMP, le Tribunal administratif s’est toutefois limité à constater l’illicéité de la décision d’adjudication, sans se prononcer sur la légalité du contrat.
La recourante forme un recours en matière de droit public ainsi qu’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l’arrêt constate la nullité du contrat ou, subsidiairement, enjoint au pouvoir adjudicateur de résilier le contrat. Le Tribunal fédéral doit déterminer, premièrement, si l’art. 58 al. 2 AIMP est applicable lorsque les contrats de marchés publics ont été conclus en violation du droit des marchés publics et, secondement, si la validité d’un contrat de marché public peut être contestée à l’occasion du recours contre la décision d’adjudication.
Droit
Les conditions de recevabilité pour former un recours en matière de droit public contre une décision en matière de marché public ne sont pas réalisées (art. 83 let. f LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est en revanche recevable. En effet, en matière de marchés publics, le soumissionnaire évincé dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 115 let. b LTF) à recourir lorsqu’il peut rendre vraisemblable qu’il obtiendrait le marché public en cas d’admission du recours.
Le Tribunal fédéral doit encore déterminer si les conclusions de la recourante relatives à la nullité, respectivement à la résiliation du contrat, sont recevables ou s’il s’agit de conclusions nouvelles, irrecevables selon l’art. 99 al. 2 LTF. Des conclusions sont nouvelles au sens de l’art. 99 al. 2 LTF si elles élargissent l’objet du litige. L’objet du litige est déterminé par les conclusions prises devant l’autorité précédente. En l’espèce, les conclusions relatives au contrat n’ont pas pour conséquence d’étendre l’objet du litige. En effet, celles-ci poursuivent toujours le même but et portent sur le rapport juridique à la base de la décision de l’autorité inférieure. Elles ont uniquement été adaptées aux circonstances de fait et de droit qui ont changé depuis la date du dépôt du recours auprès de l’instance précédente. Partant, ces conclusions sont recevables et le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.
Sur le fond, le recourant invoque une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l’art. 58 al. 2 AIMP. L’art. 58 al. 2 AIMP limite la protection judiciaire à une constatation de l’illicéité de la décision d’adjudication lorsque le contrat a déjà été conclu. Cette disposition n’est toutefois applicable que lorsque le contrat a été conclu conformément au droit des marchés publics. En d’autres termes, cette disposition est applicable lorsque l’effet suspensif n’a pas été accordé au recours formé contre la décision d’adjudication, respectivement lorsqu’il a été retiré. Cette conclusion s’impose également afin d’assurer l’effectivité de la protection judiciaire. En l’espèce, le Tribunal cantonal est tombé dans l’arbitraire en considérant que l’art. 58 al. 2 AIMP était applicable au litige.
Le Tribunal fédéral doit à présent se prononcer sur les conséquences d’une procédure d’adjudication viciée sur le contrat de marché public lorsque l’art. 58 al. 2 AIMP n’est pas applicable.
En principe, un contrat conclu en violation du droit des marchés public n’est pas nul. Constater systématiquement la nullité du contrat dans une telle hypothèse compromettrait excessivement la sécurité juridique et léserait, de manière disproportionnée, les intérêts en jeu. La nullité doit demeurer réservée à des cas de vices particulièrement graves (p.ex. corruption). Pour le surplus, les tribunaux administratifs ne sauraient se prononcer directement sur la validité du contrat. Ce dernier constitue en effet un contrat de droit privé, exclu pour ce motif de leur compétence. En revanche, les tribunaux administratifs peuvent octroyer des injonctions visant à régir l’activité contractuelle du pouvoir adjudicateur. Par injonction, les tribunaux administratifs peuvent notamment ordonner au pouvoir adjudicateur de résilier ou d’amender un contrat de marché public, de manière à rétablir une situation conforme au droit matériel le plus rapidement possible. Ces injonctions sont toutefois limitées par le principe de proportionnalité. Pour ce motif, les injonctions ne peuvent porter que sur des mesures pro futuro. A contrario, des injonctions portant sur des prestations contractuelles déjà fournies sont exclues.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours. Il renvoie la cause au Tribunal administratif, lequel devra examiner si le contrat est nul, subsidiairement si les conditions d’une injonction tendant à la résiliation du contrat sont réalisées.
Note
L’arrêt du Tribunal fédéral comble une lacune significative de la protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par les organes étatiques. Le présent arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’ATF 148 II 564 (résumé in : LawInside.ch/1292) et confirme que le contrôle judiciaire effectué par les tribunaux administratifs peut s’exercer sur l’activité contractuelle (i.e. non-décisionnelle) des organes étatiques. Si la conclusion de l’arrêt est satisfaisante, sa motivation n’est, à notre sens, pas entièrement convaincante. Elle appelle une série de précisions concernant premièrement la délimitation de l’objet de la contestation, deuxièmement le fondement juridique du pouvoir d’injonction des tribunaux administratifs et finalement, l’objet et les limites du pouvoir d’injonction.
La première difficulté soulevée par l’approche du Tribunal fédéral tient à la délimitation de l’objet de la contestation. Le contentieux de droit public suisse se caractérise par le fait qu’il est fondé sur la décision administrative. Les administrés ne bénéficient de la protection judiciaire que pour contester les décisions qui les affectent. Dans une même mesure, le contrôle judiciaire ne déploie d’effets juridiques directs que vis-à-vis des décisions, les divers actes pouvant être contrôlés à titre préjudiciel (p.ex. ordonnance administrative ou législative, lois, etc.) demeurant formellement valides. En principe, l’objet de la contestation est constitué, tout au plus, du rapport juridique fixé par la décision administrative attaquée en première instance. En effet, quand bien même l’objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est fixé par le dispositif de l’arrêt attaqué, l’objet de la contestation lors de la procédure contentieuse cantonale ou fédérale de première instance est délimité par une décision administrative (au sujet de l’extension de l’objet de la contestation, cf. TF, 10.11.14, 9C_636/2014, c. 3.1). Un contrat ne constituant pas un acte attaquable dans le cadre d’une procédure administrative de recours (p.ex. art. 44 PA ; art. 53 al. 1 AIMP), il n’est de facto pas compris dans l’objet de la contestation devant un tribunal cantonal et conséquemment devant le Tribunal fédéral. Dans l’arrêt ici résumé, le Tribunal fédéral n’a traité que de la problématique sous l’angle de l’objet du litige. Or, de jurisprudence constante, l’objet du litige est constitué des conclusions des parties, lesquelles ne sauraient excéder l’objet de la contestation (p.ex. ATF 142 I 155, c. 4.4.2). En conséquence, l’objet du litige, tel que délimité par le Tribunal fédéral, excède en réalité l’objet de la contestation, le contrat (de droit privé) ne pouvant faire l’objet d’un recours selon le droit ordinaire de procédure.
La deuxième difficulté soulevée par l’approche du Tribunal fédéral tient au fondement juridique même du pouvoir d’injonction. Dans l’ATF 148 II 564, le Tribunal fédéral a fondé le pouvoir d’injonction des tribunaux sur un principe général selon lequel (c. 8.2) « [il] est (…) admis de manière générale que les autorités peuvent ordonner les mesures nécessaires au rétablissement d’un état conforme au droit, ce sans même qu’aucune base légale ne les y autorise expressément » ainsi que par analogie aux instructions contraignantes pouvant accompagner l’annulation d’une décision (c. 8.3 ; p.ex. art. 107 al. 2 LTF ; art. 61 al. 1 PA). Ces affirmations nous semblent incorrectes. En droit suisse, les tribunaux administratifs ne peuvent qu’annuler ou réformer les décisions administratives, à l’exclusion de tout autre acte étatique, à moins qu’une base légale expresse ne les y autorise (p.ex. art. 82 let. b LTF). Il en est de même des instructions accompagnant l’annulation d’une décision. Celles-ci ne visent qu’à régir l’instruction ou certains aspects juridiques de la procédure décisionnelle devant l’autorité inférieure. En d’autres termes, ces instructions ne produisent un effet que sur l’objet de la contestation. Faute que le contrat ne constitue l’objet de la contestation, il ne saurait faire l’objet d’une sanction de la part des tribunaux. Dans l’arrêt ici résumé, le Tribunal fédéral a encore fondé le pouvoir d’injonction sur la nécessité d’assurer l’effectivité de la protection juridique et la réalisation du droit des marchés publics (not. c. 5.4.2, c. 5.4.5 et c. 7). Ce fondement est également problématique dans la mesure où la protection juridique effective ne constitue – à tout le moins ne constituait – pas un principe général du droit suisse. En effet, le droit public suisse favorise fréquemment des mécanismes de contrôle politique aux mécanismes de contrôle juridique (ainsi not. ATF 146 I 145, c. 4.3). Le droit à une protection juridique effective a longtemps découlé des art. 6 ou 13 CEDH. Lorsque ces dispositions n’étaient pas applicables, l’effectivité de la protection juridique dépendait essentiellement du droit de procédure car le droit suisse ne prévoyait pas de garantie générale de protection juridique effective (ATF 130 I 388, c. 4).
A notre sens, l’art. 29a Cst. apporte un fondement constitutionnel positif permettant de résoudre ces difficultés. L’art. 29a Cst. constitue une garantie générale de l’accès au juge, pensée sur le modèle des § 19 Abs. 4 GG ainsi que des art. 6 et 13 CEDH, tout en présentant un champ d’application matériel plus étendu. Elle garantit non seulement un accès au juge mais également un droit à une protection judiciaire effective. Cette dernière composante de la garantie constitutionnelle de l’accès au juge n’a encore fait l’objet que de peu de développements jurisprudentiels. Au regard de la genèse de la disposition, on peut néanmoins s’inspirer des principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 13 CEDH afin de définir le contenu du droit à la protection judiciaire effective. Un recours n’est effectif au sens de l’art. 13 CEDH que s’il «[empêche] la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [fournit] un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (CrEDH [GC], 26.10.2000, Kudła c. Pologne, [requête N 30210/96], § 158). La sanction juridictionnelle doit ainsi conduire à une amélioration de la situation matérielle du justiciable. Additionnellement, une procédure n’est effective que si elle n’impose pas de charge déraisonnable aux justiciables. Tel peut notamment être le cas lorsque les justiciables sont contraints à engager deux procédures distinctes pour faire valoir la même prétention de droit matériel (voir not. CourEDH, 31.08.2018, Balogh and Others v. Slovakia, application no 35142/15, § 57 ; CourEDH, 6.10.2005, Lukenda c. Slovénie Requête no 23032/02, § 70).
En matière de marchés publics ou de concession, la protection judiciaire n’est, à notre sens, effective que si elle permet au justiciable, en cas d’admission du recours, de (re)présenter son offre lors d’une procédure de mise au concours légale en vue de l’obtention du contrat. Lorsque le contrat a déjà été conclu, une injonction contraignant les pouvoirs publics à résilier le contrat en question, constitue le standard minimum à une protection judiciaire effective. A contrario, exiger du justiciable qu’il agisse, en toute hypothèse (c. 8.4), d’abord par les moyens du droit administratif afin de constater l’illégalité de la décision d’adjudication, puis par les moyens du droit civil afin d’obtenir l’annulation du contrat, entraine une multiplication des procédures susceptibles de violer le droit à une protection judiciaire effective. Dans une même mesure, le système « classique » de la protection judiciaire en matière de contrats de marché public et de concession, consistant à obtenir par le biais d’une première procédure la constatation d’illégalité de la décision d’adjudication puis, par une seconde procédure en responsabilité, des dommages-intérêts, doit être analysé comme une atteinte à l’art. 29a Cst. La garantie de la procédure effective au sens de l’art. 29a Cst. impose que le justiciable puisse contester au sein de la même procédure la légalité de la décision d’adjudication ainsi que la légalité du contrat. L’objet de la contestation ne constitue, dans cette perspective, pas exclusivement la décision d’adjudication mais bien la « cause » au sens de l’art. 29a Cst. L’objet de la contestation, constitutionnellement défini, comprend tant la décision d’adjudication que tous les actes étatiques subséquents portant atteinte aux intérêts du justiciable.
En tant que droit constitutionnel, l’art. 29a Cst. ne peut être restreint qu’aux conditions de l’art. 36 Cst. Partant, dès lors qu’une loi de procédure (inter-)cantonale (art. 190 Cst.) ne permet pas de garantir la protection judiciaire effective, il appartient aux autorités judiciaires de déterminer si celle-ci vise à restreindre l’art. 29a Cst. Si tel n’est pas le cas (lacune), les conditions de la protection judiciaire découlent exclusivement de l’art. 29a Cst. Si tel est le cas, la loi cantonale de procédure doit satisfaire aux conditions de l’art. 36 Cst. A défaut, les mesures à prendre afin d’assurer une protection judiciaire effective découlent directement de l’art. 29a Cst. Ainsi, on peut, à notre sens, inférer du droit à une protection judiciaire effective un pouvoir général d’injonction des tribunaux administratifs de manière à protéger les intérêts des justiciables de l’activité étatique non-décisionnelle. Si, dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 58 al. 2 AIMP ne s’appliquait pas, on ne saurait exclure que des dispositions procédurales limitant le droit à la protection judiciaire effective telles que l’art. 58 al. 2 AIMP soient déclarées inconstitutionnelles dans un cas d’espèce.
Une dernière remarque s’impose encore concernant l’objet et les limites des injonctions. L’injonction constitue une sanction juridictionnelle largement répandue en Europe et aux Etats-Unis. Elle se caractérise par sa souplesse, étant avant tout utilisée par les tribunaux dans des juridictions ne connaissant pas ou peu d’exigences procédurales strictes relatives à la forme de l’acte attaquable. Des injonctions ont pu ainsi être utilisées afin de contraindre l’administration à effectuer des actes matériels ou juridiques, à interdire à l’administration d’appliquer une loi à un individu, un groupe d’individus ou jusqu’à récemment, de manière générale. Elles ont également été employées afin de contraindre les pouvoirs publics à remédier à des lacunes normatives.
Ces diverses injonctions ont en commun de chercher à assurer pleinement la réalisation du droit matériel. Les limites au pouvoir d’injonction ne découlent donc pas du droit de procédure mais du droit matériel. Selon le Tribunal fédéral, la principale limite au pouvoir d’injonction découle du principe de proportionnalité (c. 6.4.1 et c. 8.1). Cette affirmation doit, à notre sens, être nuancée dans la mesure où d’autres normes de droit matériel pourraient participer à restreindre les injonctions. Ainsi, la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), respectivement le droit au respect des promesses du co-contractant privé, sont susceptibles de poser une limite de droit matériel à l’injonction.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l’injonction tendant à la résiliation du contrat, in: https://lawinside.ch/1610/