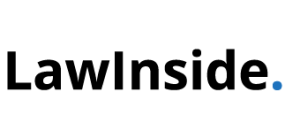Les conséquences d’un cumul d’actions prohibé par la loi
Lorsqu’un cumul d’actions ne respecte pas les conditions prévues à l’art. 90 CPC, le tribunal peut disjoindre les causes (art. 125 let. b CPC).
Faits
Une employée ouvre action devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève contre la société qui l’employait. Elle prend des conclusions à hauteur de CHF 538’157, dont CHF 21’285 à titre d’indemnité pour violation de la loi sur l’égalité.
La société soulève l’exception d’irrecevabilité. En effet, la procédure simplifiée s’appliquerait indépendamment de la valeur litigieuse dès lors que le litige relève de la loi sur l’égalité (art. 243 al. 2 let. a CPC). La demande cumulerait ainsi une action soumise à la procédure simplifiée et une autre action soumise à la procédure ordinaire. Or un pareil cumul serait prohibé selon l’art. 90 let. b CPC.
Son exception est rejetée tant par le Tribunal que par la Cour de justice.
Saisi par la société, le Tribunal fédéral en profite pour préciser les conséquences d’un cumul d’actions contraire à l’art. 90 let. b CPC.
Droit
L’art. 93 al. 1 let. b LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.… Lire la suite