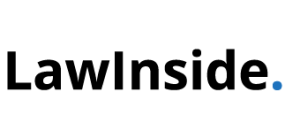L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP)
ATF 144 IV 189 | TF, 25.04.2018, 6B_1023/2017*
En application de l’art. 362 al. 4 CPP par analogie, les déclarations faites par les parties dans le cadre d’une procédure simplifiée qui n’aboutit pas ne sont pas exploitables. L’art. 141 al. 5 CPP trouve ainsi application : les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Faits
Dans le cadre d’une procédure ouverte notamment pour brigandage qualifié, le Ministère public central du canton de Vaud accepte la mise en oeuvre de la procédure simplifiée puis, environ un mois plus tard, constate qu’elle n’a pas abouti. Il retranche alors du dossier un procès-verbal d’une audition ayant eu lieu durant cette période et le conserve dans une chemise scellée sur laquelle il est indiqué « Procédure simplifiée, ne doit pas être ouvert, confidentiel ». Le prévenu est condamné par les deux instances cantonales à une peine privative de liberté de six ans.
Dans son recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, le prévenu soutient notamment que le Ministère public aurait proposé, dans le cadre de la procédure simplifiée, une peine de quatre ans et demi. Dès lors, selon le prévenu, le Ministère public aurait eu un comportement contraire à la bonne foi en requérant sept ans de peine privative de liberté devant les instances cantonales, sans aucune justification quant à l’écart entre la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée et la peine requise.… Lire la suite