Le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par une manifestante pour le climat
Le blocage non autorisé et prolongé d’un axe routier majeur, paralysant la circulation et les transports publics, constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) ainsi qu’une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). La tolérance des autorités à l’égard de manifestations pacifiques n’exclut pas la responsabilité pénale des manifestants pour leurs actes illicites.
Faits
Le 22 octobre 2022, une militante pour le climat s’est collé la main au sol lors du blocage du pont du Mont-Blanc avec cinq autres manifestants. Cette perturbation a empêché la circulation des véhicules et des Transports publics genevois (TPG) dans les deux sens pendant une heure et 20 minutes et mobilisé plusieurs services de police et de secours.
En janvier 2024, le Tribunal de police genevois condamne la militante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80 le jour, avec sursis pendant trois ans, pour contrainte (art. 181 CP) et entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP).
Suite au rejet de son appel par la Cour de justice genevoise, l’activiste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le blocage constitue un moyen de contrainte illicite, si son intensité et son ampleur représentent une entrave aux services d’intérêt général et si la condamnation pénale de la manifestante viole la liberté de réunion (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et la liberté d’expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
Droit
Selon l’art. 181 CP, est coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte devient illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné au vu du but visé ou encore lorsque le moyen conforme au droit se révèle abusif ou contraire aux mœurs (arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023, résumé in Lawinside.ch/1374/).
En l’espèce, le blocage d’une trentaine de véhicules sur le pont et de la circulation en centre-ville a entravé la liberté d’action de nombreux usagers et constitue un moyen de contrainte. Il revêt une intensité et un effet propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne, car le blocage concernait la totalité du pont, un lieu central et stratégique, pour une durée d’une heure et 20 minutes un samedi après-midi.
Aucune autorisation n’avait été délivrée pour user du domaine public, de sorte que le moyen de contrainte est illicite. Cet usage est par ailleurs disproportionné, puisque les manifestants ont choisi de bloquer le pont du Mont-Blanc, soit un axe majeur de l’hypercentre genevois, un samedi en pleine journée. Ils visaient ainsi directement la paralysie du trafic. Au contraire, ils auraient pu demander une autorisation (arrêt 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024, résumé in Lawinside.ch/1425/), agir par initiative populaire (art. 139 Cst.), par référendum facultatif (art. 141 Cst.) ou par pétition (art. 33 Cst.). Enfin, le moyen de contrainte est abusif, car le lieu bloqué n’avait aucun lien de connexité avec les revendications de l’activiste, qui portaient sur la rénovation thermique des bâtiments et l’inaction face à l’urgence climatique (Renovate Switzerland). Il découle de ce qui précède que l’infraction de contrainte est réalisée.
Selon l’art. 239 ch. 1 CP (première hypothèse), est coupable d’entrave aux services d’intérêt général quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications. Cette disposition vise en premier lieu à protéger l’intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (arrêt 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024, résumé in Lawinside.ch/1425/). L’entrave doit revêtir une certaine intensité ; son ampleur s’apprécie au regard des circonstances propres au service touché et ne signifie pas que l’entrave doit nécessairement perturber l’ensemble ou la majeure partie du service.
En l’occurrence, l’action a effectivement entravé les services des TPG. L’intensité de l’entrave est suffisante, car les perturbations ont duré pendant près de trois heures et avec une ampleur importante sur onze lignes de bus, trolleybus et trams des TPG, ce qui a indirectement entraîné des retards en cascade sur le réseau, touchant au moins des centaines d’usagers. Le comportement de l’activiste réalisant les éléments constitutifs des art. 181 et 239 CP, lesquels protègent des biens juridiques et des cercles de personnes distincts, il y a lieu de retenir un concours idéal (art. 49 CP).
Finalement, la militante pour le climat estime que sa condamnation viole sa liberté de réunion (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et sa liberté d’expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
Puisque le blocage d’un axe routier est le but principal de l’action, l’activiste ne peut toutefois pas invoquer son droit à la liberté d’expression en raison de la nature limitée de ses actes. Il s’agit d’examiner si sa condamnation en tant que restriction à la liberté de réunion est fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnée au but visé (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH et 36 Cst.).
Tout d’abord, toute restriction à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH). En principe, la CourEDH admet que les mesures poursuivent un ou plusieurs buts énumérés par la disposition, sauf si elles sont manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances d’espèce.
En l’espèce, la condamnation pénale poursuit trois buts : la sûreté publique, notamment la sécurité routière d’un axe central ; la défense de l’ordre, en raison de l’absence d’autorisation pour la manifestation ; et la protection des droits et libertés d’autrui, soit notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques. Dans son arrêt Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 173-174, la CourEDH a reconnu que des perturbations intentionnelles des activités quotidiennes et licites d’autrui, d’une ampleur au-delà de l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent constituer des « actes répréhensibles » qui peuvent justifier l’imposition de sanctions pénales. Par ailleurs, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir dissuader les manifestants de défendre leurs opinions.
Enfin, la proportionnalité de la restriction s’apprécie notamment selon la durée et l’ampleur du trouble à l’ordre public, la possibilité pour les participants d’exprimer leurs opinions, les méthodes de dispersion de la police et les peines pénales infligées.
Or, la condamnation ne sanctionne pas la participation en elle-même à la manifestation, mais les deux infractions commises dans le cadre d’une manifestation alors qu’elles n’étaient pas nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. La tolérance de la police porte sur l’exercice de la liberté de réunion par les manifestants et n’exclut pas une procédure pénale engagée à leur encontre. Par ailleurs, les outils démocratiques n’offrent pas de résultats immédiats, mais ont permis à la population de se prononcer au niveau fédéral sur plusieurs objets en matière de politique climatique ces dernières années.
En l’absence de violence, les autorités doivent faire preuve de tolérance face aux manifestations pacifiques non autorisées afin de garantir la substance de la liberté de réunion protégée par l’art. 11 CEDH. Au vu de l’ampleur et de la durée des troubles causés par la manifestation, les activistes ont malgré tout pu exercer leur liberté de réunion avant l’intervention de la police, qui a laissé plusieurs manifestants quitter librement le pont sans poursuite pénale. Enfin, l’activiste ayant reçu une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, cette sanction demeure légère. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas de violation de la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Nadia Masson, Le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par une manifestante pour le climat, in: https://lawinside.ch/1643/
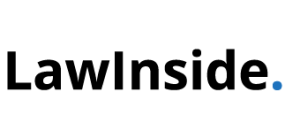






Trackbacks (rétroliens) & Pingbacks
[…] de toucher une grande partie du réseau ou son intégralité (TF, 6B_112/2025, c. 2.4, résumé in LawInside.ch/1643/). Pour déterminer si une manifestation non autorisée perturbe des services de transports publics […]
Les commentaires sont désactivés.