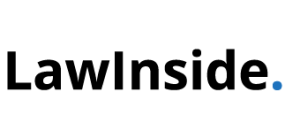Respect des clauses de réclamation et interruption de causalité: Le Tribunal fédéral se montre intransigeant
En cas d’ordre frauduleux et en dehors des cas de banque restante, le défaut de réclamation du client dans le délai convenu contractuellement représente une faute concomitante qui interrompt la causalité entre le dommage subi et la faute grave de la banque.
Faits
Une fondation est titulaire d’un compte auprès d’une banque genevoise. Il ressort de la documentation contractuelle une clause de transfert de risque ainsi qu’une clause de réclamation indiquant qu’en cas d’avis portant sur un ordre frauduleux la fondation est tenue de les contester dans un délai de 30 jours.
En avril 2017, un fraudeur prend le contrôle de la boîte email du comptable du bénéficiaire de la fondation et parvient à convaincre un membre du conseil de fondation d’ordonner à la banque un transfert de USD 650’000 sur un compte à Hong Kong et un autre de USD 103’000 à Henan en Chine. La banque notifie les avis de débit de ces deux transferts les 13 avril et 2 mai 2017. La fondation ne conteste pas la validité de ces opérations dans le délai de 30 jours précité.
La fondation ouvre action en paiement contre la banque pour un montant de USD 753’000. Elle obtient gain de cause devant le Tribunal de première instance de Genève avant que la Cour de justice n’admette l’appel de la banque. Se référant au raisonnement en trois étapes du Tribunal fédéral en matière d’ordres frauduleux (cf. not. ATF 146 III 326, résumé in Lawinside/973), la Cour cantonale estime – selon les explications du Tribunal fédéral (cf. partie en fait, let. B de l’arrêt ici commenté) – que la banque avait bel et bien commis une faute grave l’empêchant de se prévaloir de la clause de transfert de risque. Toutefois, en ne contestant pas les opérations frauduleuses dans un délai de 30 jours, la fondation avait commis une faute concomitante laquelle a interrompu le lien de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage. Sur recours de la fondation, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si cette absence de réclamation est bien une faute concomitante interruptive de causalité.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’en vertu de la clause de réclamation, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès réception de l’avis d’exécution de l’ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l’opération ou le relevé est réputé accepté par lui. Se référant à la doctrine, le Tribunal fédéral souligne que les communications de la banque ne servent pas seulement à l’information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d’écritures erronées, voire d’opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Faute de contestation, même s’il n’a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification.
Reprenant le considérant 5.2.2 d’un arrêt 4A_161/2020, le Tribunal fédéral souligne ensuite que, en présence d’une clause de banque restante, une faute grave de la banque peut rendre inopposable la clause de réclamation. En revanche, en cas d’envoi de relevé par la voie ordinaire (donc en l’absence de banque restante), le client qui ne s’oppose pas est réputé avoir approuvé le relevé. Il faut alors considérer que, « [d]ans une telle situation, la faute concomitante du client interrompt le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client ».
En l’espèce, le fait pour la fondation de n’avoir pas réclamé dans un délai de 30 jours est constitutif d’une faute concomitante interruptive de causalité. Partant, le recours est rejeté.
Note
Le raisonnement du Tribunal fédéral n’est pas nouveau. Il ressort déjà d’un arrêt de 2020, 4A_161/2020. En résumé, il consiste à dire que, en dehors des cas de banque restante, si la faute grave de la banque peut rendre inopposable une clause de réclamation, la faute concomitante du client réactualise l’opposabilité de cette clause. Bien qu’ancré jurisprudentiellement dans au moins deux décisions, ce raisonnement prête le flanc à la critique et appelle quatre remarques.
Premièrement, sans le dire, le Tribunal fédéral vient modifier certains aspects de sa méthode en trois étapes (sur cette méthode, cf. not. ATF 146 III 326, résumé in Lawinside/973 et commenté par Célian Hirsch). Selon cette méthode, dans la première étape, le tribunal doit examiner si les prélèvements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client. Ce n’est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le tribunal doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la clause de transfert de risque, le dommage est à la charge du client étant précisé qu’en présence d’une faute grave de la banque (art. 100 CO), la clause de transfert de risque est inopposable au client. Selon le Tribunal fédéral, « [c]e n’est enfin que lorsque le dommage est subi par la banque que le [tribunal] peut encore devoir examiner (troisième étape) si la banque peut opposer, en compensation à l’action en restitution de son client, une prétention en dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) parce que celui-ci aurait fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage en violant ses propres obligations (par exemple, en ne contestant pas dans le délai convenu les opérations irrégulières ou infondées, respectivement en ne consultant pas son dossier de banque restante) » (ATF 146 III 121, c. 2; nous soulignons) .
On comprend donc du raisonnement en trois étapes présenté ci-dessus que le défaut de réclamation du client peut représenter, selon les circonstances, une faute du client dans le contexte de l’analyse de la troisième étape. Cependant, dans l’arrêt ici commenté, ce n’est pas ce que dit le Tribunal fédéral. En effet, il indique que, en dehors des cas de banque restante, le défaut de réclamation du client est par définition une faute concomitante interruptive de causalité. En d’autres termes, en cas d’envoi postal ordinaire, il semblerait que l’action en paiement du client qui n’aurait pas respecté le délai de réclamation serait toujours vouée à l’échec. Cela est surprenant dans la mesure où le Tribunal fédéral semble justifier cette approche même en présence d’une faute grave de la banque; selon le Tribunal fédéral, en présence d’envoi postaux ordinaires, la faute grave de la banque n’aurait pas d’emprise sur la validité de la clause de réclamation.
Deuxièmement, le raisonnement du Tribunal fédéral s’inscrit mal dans sa méthode en trois étapes. Alors que dans l’ATF 146 III 121 précité il était clair que le défaut de réclamation (et plus généralement la faute du client) serait à prendre en compte dans la troisième étape, depuis l’ATF 146 III 326 (résumé in Lawinside/973 et commenté par Célian Hirsch), il semblerait que cette faute puisse être également prise en considération dans la deuxième étape (cf. à ce titre l’analyse de Célian Hirsch in Lawinside/947). En effet, depuis l’ATF 146 III 326, le Tribunal fédéral utilise occasionnellement ce considérant:
« Lorsque les parties ont conclu une clause de transfert de risque, il n’y a pas de troisième étape comme c’est le cas lorsque le système légal s’applique […]. C’est dans le cadre de l’examen de la faute grave de la banque, qui est réservée (art. 100 al. 1 CO par analogie […]), que le juge doit ensuite examiner la faute concomitante du client comme facteur d’interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l’indemnité qui lui est due ».
Ce considérant est repris dans le considérant 3.3 de l’arrêt ici commenté. Il ressort par ailleurs d’au moins deux autres décisions du Tribunal fédéral (TF, 4A_9/2020, c. 4.2 et TF, 4A_161/2020, c. 3.2).
Ce raisonnement du Tribunal fédéral est quelque peu énigmatique. Il semblerait que le Tribunal fédéral considère que la faute concomitante du client peut mettre en échec l’application (pourtant impérative) de l’art. 100 al. CO et donc permettre, malgré une faute grave de la banque, de maintenir la validité d’une clause de transfert de risque; cette analyse devant se faire dans la deuxième phase de l’analyse en trois étape (cf. ég. le commentaire de Célian Hirsch in CDBF). Avec ce considérant, le Tribunal fédéral nous semble prendre un virage peu heureux. Il faudrait en effet éviter que le droit suisse consacre un droit à échapper à toute responsabilité même en présence d’une faute grave au motif que le co-contractant aurait lui-même commis une faute, même de gravité relative.
Dans l’arrêt ici commenté, le raisonnement (peu heureux) décrit ci-dessus amène le Tribunal fédéral à considérer ce qui suit:
« lorsque les avis de débit en relation avec les ordres frauduleux […] ont été communiqués au client par la voie ordinaire (et non en banque restante) et qu’il ne s’y est pas opposé dans le délai convenu, il est censé les avoir approuvés. […] Dans une telle situation, la faute concomitante du client interrompt le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client » (c. 5.1.2)
Ce considérant rend encore plus énigmatique le raisonnement décrit précédemment. En effet, le Tribunal fédéral semble procéder à une analyse qui consiste à vérifier si l’art. 100 al. CO invalide la clause considérée (ce qui est une analyse qui appartient à la deuxième phase de la méthode en trois étapes) tout en mentionnant « le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client » (nous soulignons). Cette analyse est triplement curieuse d’un point de vue méthodologique.
- Premièrement, il semblerait que le Tribunal fédéral accepte que la deuxième phase de son raisonnement en trois étapes ne porte pas uniquement sur l’analyse de la validité d’une clause de transfert de risques, mais également sur d’autres clauses (ici de réclamation) ce qui nous semble rompre avec l’essence même de cette méthode en trois étapes, laquelle, au niveau de sa deuxième phase, est destinée à déterminer si la clause de transfert de risque est valable et donc qui de la banque ou du client doit supporter le dommage.
- Deuxièmement, le Tribunal fédéral mentionne dans cette deuxième phase, le dommage subi, alors que la question du dommage appartient à la troisième phase.
- Et troisièmement, le Tribunal fédéral mentionne « le dommage subi par le client« . Or, si le dommage est subi par le client, c’est bien que la clause de transfert de risque est pourvue d’effets (ce qui n’est pas le cas ici) et que la troisième phase devient superfétatoire.
Matériellement, cette analyse n’est pas moins curieuse puisqu’elle permet en quelque sorte de compenser la faute grave de la banque par le simple fait que le client aurait raté un délai, sans analyser la gravité de la faute du client qui ne respecterait pas ledit délai, lequel ressort au demeurant de conditions générales. Cette analyse rompt avec l’ATF 146 III 121, c. 2 qui, dans une approche nuancée et bienvenue, prévoyait que le défaut de réclamation pouvait atténuer la responsabilité de la banque dans l’analyse de la troisième phase.
Le flou généré par le considérant 5.1.2 précité mériterait que dans un arrêt à venir, le Tribunal fédéral procède à quelques clarifications quant à sa méthode en trois étapes et à la place qu’une clause de réclamation peut jouer dans une telle méthode.
Troisièmement, le raisonnement du Tribunal fédéral ne tient pas compte des règles en matière de preuve. Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral indique à juste titre que les communications de la banque ne servent pas seulement à l’information du client, mais visent aussi à permettre la détection en temps utile d’opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. On distingue dans cette remarque du Tribunal fédéral le rôle causal que peut jouer la clause de réclamation dans la troisième phase de l’analyse en trois étapes : si une réclamation était intervenue à temps et que cela aurait permis d’éviter le dommage, alors le défaut de réclamation est la cause principale du dommage et efface la faute de la banque. A l’inverse, si la réclamation n’avait pas permis d’éviter le dommage, alors elle n’entrainerait aucune perturbation de la chaine causale entre la faute de la banque et le dommage; partant le client gagnerait son procès. L’analyse de la causalité permet de cette façon d’imputer la responsabilité à la partie qui a effectivement causé le dommage, et ce, en application de principes millénaires.
Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral relève ce qui suit : si la réclamation était intervenue à temps, « on ignore si la banque pouvait encore empêcher le dommage de se produire ou le diminuer » (c. 5.3.2). En d’autres termes, on ignore si le respect de la clause de réclamation aurait permis d’éviter le dommage. On ignore donc si la violation du devoir de réclamation s’inscrit en lien de causalité avec le dommage. Or la preuve de l’existence d’un lien de causalité est à la charge de la partie qui s’en prévaut (ici la banque). En l’absence d’une telle preuve, le Tribunal fédéral aurait dû considérer qu’il n’était pas prouvé que la réclamation puisse avoir joué un quelconque rôle dans l’enchainement des événements et ce faisant trancher en faveur du client. Le Tribunal fédéral a tranché l’inverse confirmant ainsi qu’il considère normativement que le défaut de réclamation du client dans le délai est par définition la cause (dépassante) du dommage subi suite à des opérations frauduleuses. Il libère ainsi les banques de devoir prouver qu’une réclamation aurait eu une quelconque incidence. En d’autres termes, il les libère de leur charge de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de réclamation et le dommage.
Quatrièmement, le Tribunal fédéral aurait pu se contenter de traiter ce cas à l’aune de la première phase de sa méthode en trois étapes. Le Tribunal fédéral se montre bien décidé à être intransigeant avec le respect de la clause de réclamation et ce faisant, en dehors des cas de banque restante, trancher en faveur des banques lorsque les clients ne respectent pas le délai de réclamation convenu contractuellement. On peut se demander pourquoi le Tribunal fédéral décide d’analyser les effets de la clause de réclamation sous l’angle de la faute concomitante et de l’interruption de causalité et non pas de l’existence d’un mandat (première étape). En effet, le Tribunal fédéral relève dans son arrêt que le défaut de contestation dans le délai contractuel entraîne ratification des ordre litigieux. Une telle ratification, au titre de l’art. 38 CO, permet d’imputer les ordres au client. Le cas échéant, les ordres sont faits avec mandat ce qui pourrait permettre au Tribunal fédéral d’arrêter son analyse à la première étape et d’éviter de revisiter quelque peu hâtivement les règles en matière de causalité, d’interruption de cette dernière et de fardeau de la preuve.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Respect des clauses de réclamation et interruption de causalité: Le Tribunal fédéral se montre intransigeant, in: https://lawinside.ch/1549/