La liberté de la presse face à la législation sur les armes : l’acquisition, la possession et le transport d’une arme sans permis par une journaliste de la RTS
ATF 151 IV 135 | TF, 12.12.2024, 6B_650/2022, 6B_664/2022
Une journaliste peut invoquer, pour justifier son comportement en vertu de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il est reconnu par l’art. 10 CEDH.
Faits
Une journaliste de la RTS commande en ligne 19 pièces imprimées en 3D nécessaires à la fabrication d’une arme sans être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. La journaliste entend sensibiliser le public aux dangers des armes imprimables en 3D et vérifier la vigilance des entreprises suisses romandes offrant ces services. Une fois les pièces reçues dans les locaux de la RTS à Genève, elle y assemble l’arme avec un collègue, prenant soin de ne pas insérer le percuteur et d’y ajouter une pièce métallique afin de rendre l’arme inopérante et détectable.
La journaliste transporte l’arme en train, depuis les locaux de la RTS à Genève jusqu’à ceux de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sans être titulaire d’un permis de port d’armes. Pendant le transport, l’arme se trouve dans le sac de sa caméra, sans percuteur ni munitions. Le reste du temps l’arme est stockée dans un tiroir fermé à clé au sein du bâtiment sécurisé de la RTS.
Le Tribunal de police reconnait la journaliste coupable du transport et de la possession de l’arme, mais l’exempte de toute peine (art. 52 CP). La Cour de justice genevoise condamne la journaliste à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’200 à titre de sanction immédiate. Cette condamnation ne porte que sur le transport de l’arme, tandis que la journaliste est acquittée concernant l’acquisition et la possession de celle-ci. Les trois chefs de prévention sont tous caractérisés par l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
La journaliste ainsi que le Ministère public genevois forment recours au Tribunal fédéral. Le Ministère public genevois conclut à la condamnation de la journaliste pour l’ensemble des chefs de prévention. La journaliste conclut à l’acquittement de tous les chefs de prévention. Le Tribunal fédéral est amené à déterminer si l’arme imprimée en 3D entre dans le champ d’application de la LArm et si un journaliste peut invoquer, pour justifier son comportement en vertu de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il est reconnu par l’art. 10 CEDH.
Droit
Premièrement, le Tribunal fédéral examine si le comportement incriminé entre dans le champ d’application de la LArm. Cette loi vise à protéger l’ordre public et a pour objectif de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions. L’art. 4 al. 1 let. a LArm définit que sont considérées comme armes à feu « les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins ». Les éléments essentiels d’une arme comprennent, pour les pistolets, la carcasse, la culasse et le canon (art. 3 let. a OArm). Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes (art. 8 al. 1 LArm). Un permis de port d’armes (art. 27 al. 1 LArm) est nécessaire pour porter une arme dans un lieu public ou pour la transporter. L’art. 33 al. 1 let. a LArm réprime quiconque qui, intentionnellement et sans droit, notamment acquiert, possède, fabrique, ou porte des éléments essentiels ou composants d’armes. Il s’agit d’infractions de mise en danger abstraite.
En l’espèce, le pistolet en question est une arme à feu pour laquelle une autorisation ou un permis est nécessaire. La journaliste n’obtient pas ces documents alors qu’elle est consciente de leur nécessité. Par conséquent, elle commet intentionnellement une infraction pénale au sens de l’art. 33 al. 1 let. LArm.
Deuxièmement, le Tribunal fédéral analyse si un journaliste peut invoquer, pour tenter de justifier son comportement dans le cadre de l’application de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il lui est reconnu en vertu de l’art. 10 CEDH. L’art. 14 CP prévoit que « quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi ». Cette disposition renvoie ainsi à d’autres dispositions légales, sans introduire de faits justificatifs en tant que tels. À ce jour, le Tribunal fédéral n’a pas précisé si, et dans quelle mesure, les normes de rang constitutionnel ou conventionnel devaient également être considérées comme des « lois » pouvant fonder des « actes autorisés » au sens de l’art. 14 CP.
En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnaît qu’une journaliste peut faire valoir la liberté d’expression (art. 10 CEDH), protégée de manière accrue au regard de son métier, afin de tenter de justifier son comportement dans le cadre de l’application de l’art. 14 CP. Ce raisonnement s’appuie sur deux arrêts de la CourEDH (Dammann c. Suisse ; Haldimann et autres c. Suisse) ayant condamné la Suisse pour violation de l’art. 10 CEDH.
Troisièmement, le Tribunal fédéral examine si l’atteinte à la liberté d’expression de la journaliste repose sur une base légale, poursuit un intérêt public et se révèle proportionnée au but visé. L’exigence de proportionnalité, au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH, implique que l’atteinte soit nécessaire dans une société démocratique et réponde à un besoin social impérieux.
En l’espèce, les conditions de base légale et d’intérêts publics sont remplies. L’art. 33 LArm constitue une base légale au sens formel suffisante dont le but est de protéger la population. Toutefois, la condamnation de la journaliste ne répond pas à un besoin social pouvant être qualifié d’impérieux. D’une part, la journaliste a mis en danger la sécurité publique de manière extrêmement abstraite et limitée dans la mesure où l’arme a été rendue inutilisable, cachée lors du transport en train et conservée dans un bâtiment sécurisé. D’autre part, les conditions matérielles nécessaires à la délivrance d’une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 28c LArm étaient a priori remplies. En outre, les actes reprochés relevaient d’une démarche strictement journalistique. Enfin, des mesures moindres, comme un simple rappel à l’ordre ou le classement de la procédure, auraient suffi à atteindre l’objectif de sécurité publique visé par la législation sur les armes.
Partant, les actes reprochés à la journaliste sont licites et son recours est admis
Note
La Cour Suprême des États-Unis vient également de publier un arrêt en matière d’armes à feu (Bondi v. Vanderstok, 604 U. S. ____ (2025), 26 mars 2025). À la différence de l’arrêt du Tribunal fédéral résumé ci-dessus, la Cour Suprême a longuement examiné la définition légale d’arme à feu. En effet, comme dans l’état de fait susmentionné, elle devait déterminer si un kit d’arme (weapon parts kits) – à savoir des pièces qui, assemblées, deviennent une arme – constitue une firearm. À cet égard, le rapport du Groupe de travail sur les armes à feu de l’ONU, publié en avril 2024, a souligné la nécessité pour les États d’adapter leurs réglementations afin qu’elles s’appliquent également aux armes imprimées en 3D.
Le Gun Control Act (GCA) a été adopté en 1968 après les assassinats du président John F. Kennedy, du procureur général Robert Kennedy et du Dr Martin Luther King Jr. Cette loi impose des réglementations plus strictes sur l’industrie des armes à feu, introduit de nouvelles infractions liées aux armes et interdit la vente d’armes et de munitions aux criminels et à d’autres catégories de personnes interdites. Le GCA définit une “firearm” notamment comme “any weapon (…) which will or is designed to or may readily be converted to expel a projectile by the action of an explosive”. Cette définition est proche de notre art. 4 al. 1 let. a LArm qui définit les armes à feu comme « les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins ». La similitude entre les définitions américaine et suisse peut s’expliquer par deux éléments clés. D’une part, l’adoption en 2001 du Protocole additionnel à la Convention des Nations contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, a introduit à son art. 3 let. a une définition harmonisée des armes à feu. Cette définition, reprise dans de nombreux cadres législatifs, pourrait avoir été influencée par le GCA qui formulait déjà ces notions essentielles. D’autre part, au niveau de l’UE, la Directive 2008/51/CE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, reprise par la Suisse dans le cadre de l’acquis de Schengen, a également contribué à uniformiser les réglementations en la matière. Là encore, il est possible que la définition du GCA ait servi de référence.
Les nouvelles technologies, comme les imprimantes 3D, permettent désormais de facilement créer et vendre des parties d’armes que des acheteurs peuvent ensuite assembler eux-mêmes. Les ghost guns se sont multipliés aux États-Unis ces dernières années, avec une hausse des actes criminels. Ainsi, l’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) a promulgué une règle afin de soumettre expressément les weapon parts kits à autorisation, conformément au Gun Control Act.
Alors que les deux premières instances judiciaires fédérales ont cassé la règlementation de l’ATF, la Cour Suprême, par 7 voix contre 2, retient une notion large de firearm qui comprend les weapon parts kits.
Dans son raisonnement, la Cour prend notamment l’exemple concret du Buy Build Shoot qui peut être monté en 21 minutes grâce à une vidéo YouTube. Comme une table Ikea constitue déjà une table, alors qu’elle vient d’être achetée et qu’elle n’a pas été montée, un weapon parts kits constitue une arme. Même son nom indique cette fonction.
Pour une analyse approfondie de l’interprétation des noms d’artefacts, et notamment la notion de firearm, cf. Waldon Brandon/Condoravdi Cleo/Pustejovsky James/Schneider Nathan/Tobia Kevin, Reading Law with Linguistics: The Statutory Interpretation of Artifact Nouns (July 01, 2024). Harvard Journal on Legislation, Volume 62 (forthcoming 2025).
Pour revenir en Suisse, il est rassurant de lire, dans l’arrêt du Tribunal fédéral, que de nombreuses entreprises actives dans l’impression 3D, contactées par la journaliste, ont refusé l’impression. En effet, elles avaient « reconnu d’emblée que les pièces en question allaient servir à la confection d’une arme à feu. Certains d’entre eux ont fait part de leur intention d’avertir la police » (faits B.b.b.). Cela étant, la journaliste a in fine bel et bien réussi à obtenir une arme à feu, sans grande difficulté. Elle a dès lors contacté la cheffe genevoise de la Brigade des armes, qui a décliné sa proposition d’interview, car « la brigade [n’était] pas confrontée à la problématique en question » (faits B.c.a.).
Cf. le documentaire de la RTS à l’origine de cette affaire.
Proposition de citation : Sébastien Picard and Célian Hirsch, La liberté de la presse face à la législation sur les armes : l’acquisition, la possession et le transport d’une arme sans permis par une journaliste de la RTS, in: https://lawinside.ch/1569/
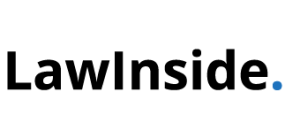







Trackbacks (rétroliens) & Pingbacks
[…] französischsprachige Besprechung dieser Urteile haben die Autoren auf dem Portal Lawinside.ch […]
Les commentaires sont désactivés.