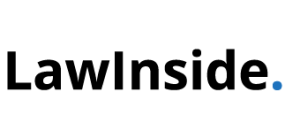La non-conformité à la Constitution d’une école secondaire pour filles
i. L’art. 15 al. 4 Cst. exclut tout enseignement religieux obligatoire. En outre, le contenu et l’organisation de l’enseignement ne doit pas être systématiquement orienté vers une croyance.
ii. Les écoles publiques doivent en principe être mixtes (art. 8 al. 3 Cst.).
Faits
En 1996, la commune de Wil (SG) et le couvent de Sainte-Catherine concluent un accord relatif à la gestion d’une école secondaire pour filles par le couvent. L’accord prévoit que l’école, dénommée « Kathi », est gérée conformément au mandat légal d’éducation et de formation.
En 2016, le Parlement communal de Wil approuve un avenant à l’accord, qui prévoit que la Fondation École Sainte-Catherine, entité de droit privé, reprend la gestion de l’école.
Plusieurs citoyens et un parti politique forment un recours contre la décision du Parlement. Après plusieurs recours successifs et un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral relatif à l’existence d’une base légale suffisante, le Tribunal administratif cantonal saint-gallois rejette le recours.
Les intéressés interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’accord conclu avec l’école tel qu’approuvé par le Parlement de la commune de Wil viole la liberté de croyance et de conscience (art. 15 Cst.) et l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 et 3 Cst.).
Droit
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine si l’accord viole la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Cette disposition protège notamment le droit de choisir librement sa religion (al. 2), le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou de suivre un enseignement religieux (al. 3), ainsi que le droit de ne pas être contraint à des actes religieux ou à un enseignement religieux (al. 4).
Le principe de neutralité religieuse de l’État concrétise la liberté de croyance et l’interdiction de discriminer en raison des convictions religieuses. L’État doit s’abstenir, dans ses actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse.
La neutralité religieuse de l’État ne suppose pas nécessairement une séparation stricte entre l’État et la religion (modèle laïque). Elle peut aussi reposer sur une attitude ouverte de manière égale à toutes les convictions (neutralité étatique). En outre, des approches cantonales différentes peuvent être admissibles. Le canton de Saint-Gall, par exemple, ne suit pas une conception laïque de l’État, mais se réfère explicitement à des principes chrétiens.
Malgré des spécificités de chaque canton, le Tribunal fédéral doit veiller au respect des garanties constitutionnelles, telles que l’art. 15 al. 4 Cst. qui exclut l’enseignement religieux obligatoire. L’enseignement religieux doit être facultatif et clairement distinct de l’enseignement ordinaire. Aucune pression ne doit être exercée sur les élèves pour qu’ils participent à un enseignement à caractère confessionnel. Par ailleurs, les contenus et méthodes d’apprentissage, ainsi que l’organisation de l’enseignement ne doivent pas être systématiquement orientés vers une croyance. Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées sans que cela ne porte atteinte à la liberté de conscience et croyance. Cela permet de garantir la paix religieuse.
En l’espèce, l’école Kathi assume une tâche publique en vertu de l’accord conclu avec la commune de Wil. Elle est ainsi considérée comme une école publique et il n’est pas exclu que certaines élèves soient obligées de la fréquenter. La commune doit donc garantir le respect de l’obligation de neutralité confessionnelle dans cette école.
L’établissement se définit comme une école catholique fondée sur des valeurs chrétiennes. Il ressort notamment de la stratégie de l’école qu’elle cherche à conduire les élèves vers la foi chrétienne. Cette orientation se manifeste dans le cadre scolaire. De nombreuses activités religieuses qualifiées « d’activités à option », sont mises en place dans le quotidien de l’école : messes, pèlerinages, célébrations liturgiques, etc. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation formelle de participer à ces activités, l’ensemble de la communauté y prend part. Elles font ainsi partie intégrante du programme d’enseignement et les élèves qui s’en abstiennent ne participent pas normalement à la vie scolaire.
Au sujet de ce premier point, le Tribunal fédéral conclut que l’orientation confessionnelle dans cet établissement dépasse le devoir de neutralité que l’on peut exiger d’une école publique et viole dès lors l’art. 15 Cst. En particulier, les activités réligieuses ne sont pas suffisamment séparées de l’enseignement ordinaire pour garantir l’absence de pression sur les étudiantes.
Dans un second temps, le Tribunal fédéral examine le grief de la violation de l’interdiction de la discrimination. Il rappelle qu’une discrimination se définit comme une inégalité de traitement qualifiée entre des personnes placées dans des situations comparables, fondée sur un critère d’identification tel que le sexe (art. 8 al. 2 et 3 Cst.).
La jurisprudence considère qu’en général, l’égalité entre femmes et hommes en matière d’éducation ne souffre généralement d’aucune exception. De plus, conformément à l’art. 8 al. 3 Cst., l’enseignement dans les écoles publiques doit être en principe mixte.
En l’espèce, dans le cadre de l’accord attribuant une tâche publique, l’école Kathi est accessible uniquement aux élèves de sexe féminin. L’organisation de cette école est donc inconstitutionnelle. En outre, l’établissement offre un programme plus étendu, notamment avec davantage de cours de musique, et est perçu comme bénéficiant d’une meilleure qualité d’enseignement. Les garçons sont donc discriminés par l’accord conclu à propos de l’école Kathi.
Au sujet de ce second point, le Tribunal fédéral constate que confier à la Fondation École Sainte-Catherine la direction d’une école secondaire publique réservée aux filles viole l’art. 8 al. 2 et 3 Cst.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut que le fonctionnement actuel de l’école Kathi n’est pas compatible avec le devoir de neutralité confessionnelle des écoles publiques et viole l’interdiction de la discrimination. Il admet le recours.
Proposition de citation : Margaux Collaud, La non-conformité à la Constitution d’une école secondaire pour filles, in: https://lawinside.ch/1601/